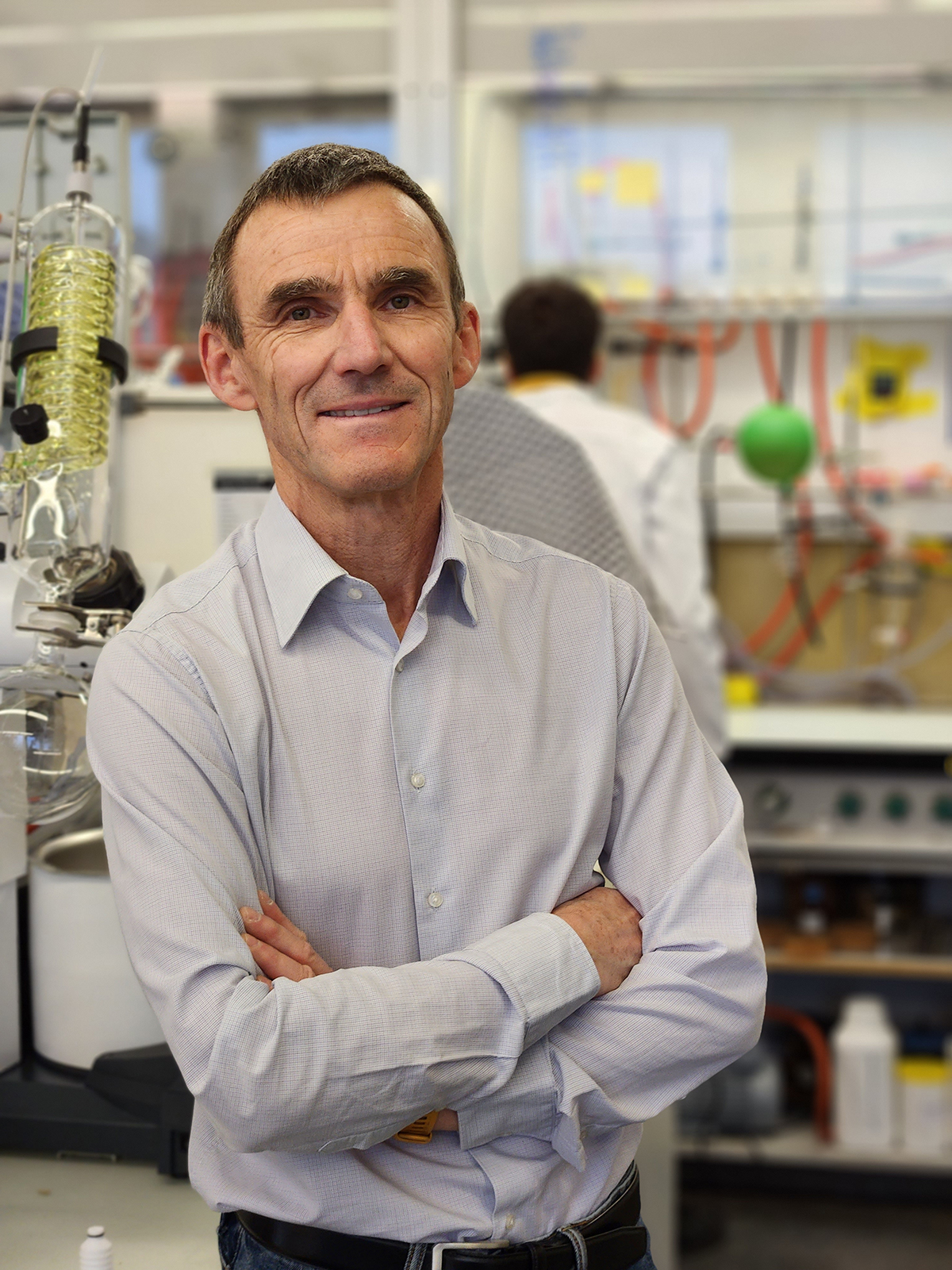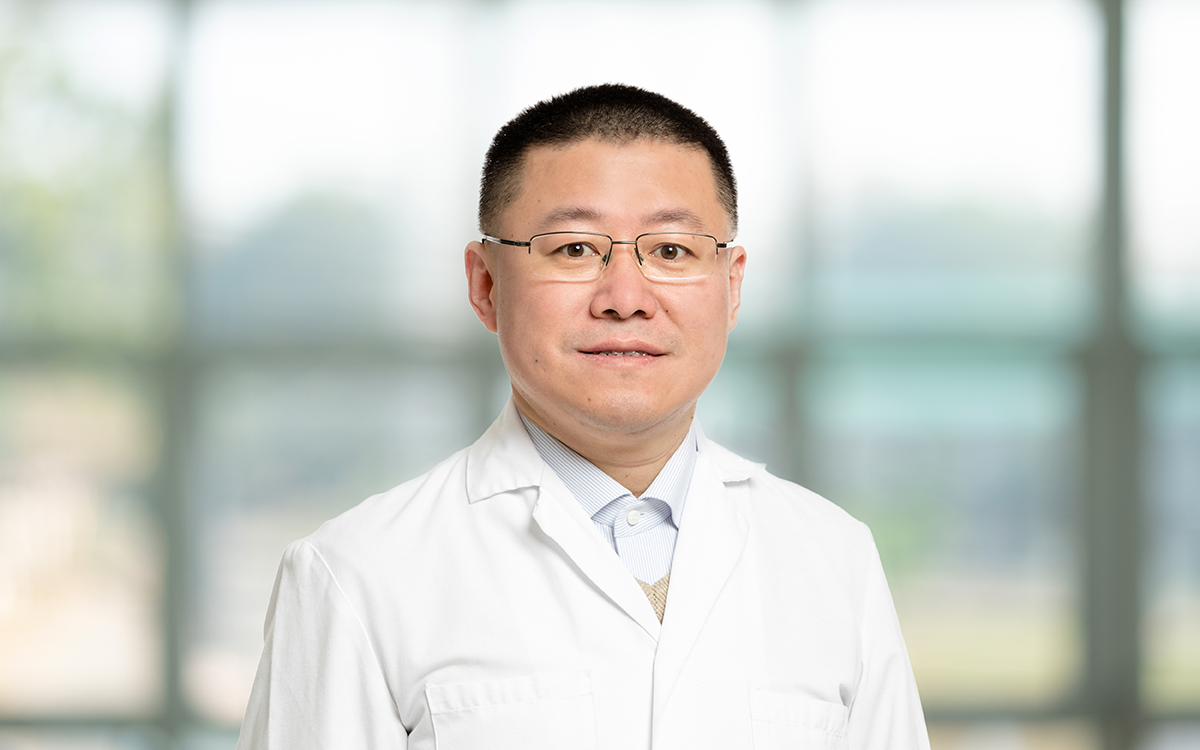Financement Sinergia pour six projets interdisciplinaires à Berne
Pour leurs six projets de recherche, dix chercheurs de l’Université de Berne reçoivent des subsides Sinergia du Fonds national suisse (FNS). Pendant une durée de quatre ans, le FNS attribuera des fonds s’élevant à près de 6.7 millions de francs au total afin de soutenir ces projets.
Le programme Sinergia du Fonds national suisse (FNS) encourage les projets communs de deux à quatre groupes qui mènent des recherches interdisciplinaires visant à ouvrir de nouvelles perspectives. Comme son nom l’indique, il s’agit d’exploiter les synergies entre les différents domaines de recherche : l’expertise et les connaissances des requérants et requérantes doivent se compléter mutuellement. Leurs projets doivent relever des défis importants dans la recherche scientifique et adopter une approche novatrice en remettant en question des modèles, des doctrines ou des méthodes existants ou en les dépassant. Les projets ouvrent de nouvelles voies de recherche et ont un fort potentiel d’impact dans le domaine académique ou au-delà.
Dans le cadre de la mise au concours actuelle du FNS, 113 projets ont été évalués et 26 ont été sélectionnés au terme d’une procédure compétitive. Six d’entre eux sont placés sous la codirection de dix chercheurs de l’Université de Berne. Le budget par projet s’élève à environ 1 million de francs. Hugues Abriel, Vice-recteur de la recherche et de l’innovation à l’Université de Berne, se félicite de ce succès : « La recherche interdisciplinaire menée par l’Université de Berne montre qu’elle est tout à fait d’actualité et qu’elle est parfaitement en réseau. En outre, les six projets Sinergia réalisés par les chercheurs bernois se distinguent avant tout par leur potentiel de profiter grandement à la société. »
Descriptions détaillées des projets et biographies succinctes :
The Food-Medicine Continuum in Vervet Monkeys: Investigations on the Interplay between Diet Quality, Stress Coping, and the Endocannabinoid SystemResponsables du projet :
Description du projetLa zoopharmacognosie cherche à déterminer si les animaux ont une capacité innée à reconnaître et à utiliser les bienfaits des plantes. L’objectif du projet est de comprendre les effets des changements d’habitudes alimentaires sur l’axe intestin-cerveau chez le vervet et dans quelle mesure ils sont liés à leur aptitude à gérer le stress et à leur comportement d’apprentissage. Les résultats préliminaires révèlent que les métabolites végétaux secondaires ingérés par les vervets peuvent améliorer leur condition physique en modulant le système endocannabinoïde (ECS). L’ECS est un réseau de lipides conservé chez les mammifères au cours de l’évolution, qui régule la transmission synaptique, l’inflammation, le métabolisme et l’apport alimentaire, ainsi que le comportement face au stress, l’apprentissage et la mémoire. Les chercheurs et chercheuses supposent que les liens étudiés entre la nourriture et le bien-être général pourront faire progresser la pratique alimentaire humaine et la fabrication de compléments alimentaires. Portrait de Jürg GertschJürg Gertsch est professeur de biochimie et de biologie pharmaceutique. Il est actuellement directeur général adjoint et l’un des codirecteurs de l’Institut de biochimie et de médecine moléculaire (IBMM). Son groupe se concentre sur l’étude du système endocannabinoïde et de la pharmacologie des cannabinoïdes, l’accent étant mis notamment sur la recherche pharmaceutique. Il mène des recherches interdisciplinaires qui englobent la pharmacologie biochimique et les analyses biomédicales. Il est cofondateur de Synendos Therapeutics, un spin-off de son laboratoire qui se consacre au développement de principes actifs neuropharmacologiques novateurs. En rétribution de ses services remarquables au profit de la pharmacologie des substances naturelles végétales, le professeur Gertsch s’est vu décerner de nombreux prix, dont le A. Vogel Award (2003), le Dr. Willmar Schwabe Award (2010) et le prix Sebastian Kneipp (2014). Contact :Prof. Dr Jürg Gertsch, Institut de biochimie et de médecine moléculaire (IBMM), Université de Berne |
Designing Inhibitors Against Clostridial Pore-Forming ToxinsResponsables du projet :
Description du projet :Il s’agit d’un projet de recherche fondamentale visant à lutter contre les toxines formant des pores. Ces poisons ont la capacité de former des pores dans la membrane cellulaire, ce qui provoque la mort de la cellule. Ils sont le plus souvent produits par des bactéries pathogènes, telles que Clostridium perfringens, et servent à augmenter les ressources de nourriture pour ces bactéries. Une équipe composée de pathologistes vétérinaires, de chimistes assistés par ordinateur et de biologistes structuraux développe des inhibiteurs peptidiques de ces toxines. Grâce à des modèles informatiques avancés et une connaissance poussée des structures des toxines, le projet vise à jeter les bases de nouvelles stratégies thérapeutiques, afin de trouver des solutions efficaces pour lutter contre les facteurs de virulence et des méthodes innovantes pour traiter les infections bactériennes. Portrait de Benoît ZuberBenoît Zuber est professeur associé et codirecteur de l’Institut d’anatomie à l’Université de Berne ainsi que chef du Département d’anatomie microscopique et de biologie structurale. Il a obtenu son doctorat en biologie structurale à l’Université de Lausanne et a effectué un séjour postdoctoral à Cambridge. Son domaine de spécialité est la biologie cellulaire structurale, avec un accent particulier sur les techniques de cryo-microscopie électronique. Benoît Zuber est, en outre, directeur scientifique de l’agence bernoise du Dubochet Center for Imaging et s’engage dans l’enseignement de l’histologie. Portrait de Horst PosthausHorst Posthaus est professeur associé de pathologie vétérinaire et directeur du programme de formation en pathologie et du Département de nécropsie de l’Institut de pathologie animale à l’Université de Berne. C’est ici qu’il a mis sur pied le groupe de recherche « Host-Pathogen Interaction ». Dans le cadre de ses recherches, Horst Posthaus étudie l’interaction entre les toxines bactériennes formant des pores et les cellules cibles dans l’organisme animal et humain. Portrait de Jean-Louis ReymondJean-Louis Reymond est professeur de chimie au Département de chimie, biochimie et pharmacie à l’Université de Berne. Il développe de nouvelles substances actives en associant la chimio-informatique et l’intelligence artificielle à la synthèse organique et les essais biologiques. Les applications se situent dans le domaine des inhibiteurs de faible poids moléculaire des transporteurs membranaires et des canaux ioniques, ainsi que des peptides antimicrobiens dirigés contre les bactéries multirésistantes (ERC Advanced Grant SPACE4AMPS) et des réactifs de transfection. Contact :Prof. Dr Benoît Zuber, Institut d’anatomie, Université de Berne Prof. Dr. Horst Posthaus, Institut de pathologie animale, Université de Berne Prof. Dr Jean-Louis Reymond, Département de chimie, biochimie et pharmacie, Université de Berne
|
Hydrography of Mesopotamia. Rivers and Channels in Babylonia from the 4th to the 1st Millennium BCEResponsables du projet :
Description du projet :La Mésopotamie devait sa richesse à ses terres fertiles qui ne pouvaient être exploitées qu’à l’aide d’un système d’irrigation complexe. D’où le rôle décisif des rivières et canaux, dont le tracé a connu plusieurs changements majeurs au fil des millénaires. Portrait de Mirko NovákMirko Novák est depuis 2011 professeur d’archéologie du Proche-Orient à l’Institut des sciences archéologiques de l’Université de Berne. Il dirige les fouilles à Sirkeli Höyük (Turquie) et est codirecteur des fouilles à Umma (Irak) et à Togolok (Turkménistan). Par le passé, il a effectué des travaux en Syrie, dernièrement à Tall Halaf. Ses recherches sont axées essentiellement sur les questions de la chronologie, de l’urbanisme et du développement architectural, selon les modes d’échanges culturels ainsi que les liens entre migration et ethnogenèse. Portrait d’Andreas ZischgAndreas Zischg est professeur de modélisation de systèmes homme-environnement à l’Institut de géographie et codirecteur du Laboratoire Mobilière de recherche sur les risques naturels au Centre Oeschger pour la recherche climatique de l’Université de Berne. Dans le cadre de son travail de recherche, Andreas Zischg s’intéresse aux risques d’inondation, à l’impact climatique et au système d’information géographique SIG. Contact :Prof. Dr Mirko Novák, Institut des sciences archéologiques, Université de Berne Prof. Dr Andreas Zischg, Institut de géographie et Laboratoire Mobilière de recherche sur les risques naturels, Centre Oeschger pour la recherche climatique, Université de Berne |
Intelligent 4D ultra-high-sensitive PET Imaging for early detection of pancreatic ductal adenocarcinomaResponsables du projet :
Description du projet :Le projet porte sur le développement de méthodes de détection précoce du cancer du pancréas à l'aide de la tomographie par émission de positrons. Pour ce faire, il est prévu d'utiliser des radiotraceurs correspondants, qui ont pour objectif de détecter des caractéristiques spécifiques des cellules tumorales. Combiné avec l'un des premiers scanners TEP/TDM corps entier hautement sensibles au monde, ainsi qu'avec le développement préclinique, y compris les analyses de simulation et les modèles animaux, l'objectif final est d'atteindre l'homme à l'aide de méthodes d'intelligence artificielle. Les méthodes de détection précoce développées dans le cadre du projet pourront finalement être appliquées à de nombreuses entités tumorales et permettre l'utilisation de la tomographie par émission de positrons pour le dépistage de groupes à risque. Portrait d’Axel RomingerAxel Rominger est professeur de médecine nucléaire et directeur de la clinique universitaire de médecine nucléaire de l'Hôpital de l'Île à Berne. La tomographie par émission de positrons et son développement méthodologique constant font partie de ses priorités scientifiques. Cela se fait avec des équipes interdisciplinaires ancrées dans la médecine nucléaire, comme la radiopharmacie pour le développement de traceurs, le développement biotechnologique et le groupe de méthodes d'intelligence artificielle. Il existe une étroite collaboration avec des groupes de chercheurs aux Etats-Unis, en Chine et en Corée du Sud. Portrait de Kuangyu ShiKuangyu Shi est physicien médical en chef et directeur du Lab for Artificial Intelligence & Translational Theranostics (AITT) à la Clinique universitaire de médecine nucléaire de l’Hôpital universitaire de Berne. Ses recherches portent sur le développement de l’intelligence artificielle et des techniques de simulation assistée par ordinateur pour l’imagerie et la thérapie en médecine nucléaire, dans le but de relier les résultats aux processus pathologiques sous-jacents. Il se consacre également au développement de méthodes « in vivo » et « ex vivo » expérimentales afin de repousser les limites de l’imagerie nucléaire microscopique. Contact:Prof. Dr ing. Kuangyu Shi, Clinique universitaire de médecine nucléaire, Inselspital, Hôpital universitaire de Berne Prof. Dr Axel Rominger, Clinique universitaire de médecine nucléaire, Inselspital, Hôpital universitaire de Berne |
Understanding the role of immuno-metabolic imprinting for sustainable weight lossResponsables du projet :
Description du projetL’augmentation du nombre de personnes en surpoids va de pair avec une augmentation du nombre de maladies telles que le diabète de type 2 et les pathologies cardiovasculaires. Bien qu'il existe plusieurs options de traitement, les résultats à long terme ne sont pas satisfaisants, car il est très fréquent que les personnes qui tentent de perdre du poids par le biais d'un mode de vie ou d'une pharmacothérapie reprennent du poids. Les résultats de ce projet fourniront une explication mécanistique claire à l'une des plus grandes énigmes du traitement clinique de l'obésité, à savoir la reprise de poids après une perte de poids réussie - un phénomène généralement connu sous le nom d'« effet yo-yo ». Le projet vise à comprendre comment une interaction défavorable entre la flore intestinale, le système immunitaire et le système endocrinien a des effets durables sur la perte de poids après une obésité. Pour ce faire, des approches multidisciplinaires seront adoptées et des synergies d'expertise en immunologie, endocrinologie, microbiome et métabolisme seront utilisées. Portait de Ziad Al NabhaniZiad Al Nabhani ist seit 2021 Assistenzprofessor in der Universitätsklinik für Depuis 2021, Ziad Al Nabhani est professeur assistant à la Clinique universitaire de Contact :Prof. Dr Ziad Al Nabhani, Département de recherche biomédicale (DBMR), Université de Berne |
Holocene hydroclimate, drought dynamics and environmental change recorded in multiple archives from SW Asia (MITRA)Responsables du projet :
Description du projet :Le projet Sinergia intitulé MITRA est un projet interdisciplinaire visant à étudier le cycle de l’eau dans la région du Tigre et de l’Euphrate au cours des quatre derniers millénaires. Considérée comme un site clé pour le développement de l’humanité, la région est associée à l’essor de l’agriculture, à l’émergence de sociétés complexes avancées et au développement des premières villes, États et empires. Le projet étudie les conditions climatiques passées, en particulier le cycle de l’eau. Des archives de proxies et modèles climatiques sont utilisés dans le cadre ce projet. Les variations extrêmes du climat au cours des 4000 dernières années sont étudiées en collaboration avec l’Université de Bâle et l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie Marine et Continentale (IMBE), Université d’Aix-Marseille. Le but est de répondre à certaines questions afin de connaître, par exemple, la durée des épisodes de sécheresse et les processus dans la région qui en ont été à l’origine. Le projet tend à fournir des éléments de compréhension qui permettront à d’autres disciplines comme l’archéologie d’étudier les effets du climat sur les sociétés complexes précoces. Portrait de Christoph RaibleChristoph Raible est professeur associé de dynamique atmosphérique à l’Université de Berne et s’intéresse aux variations climatiques passées et futures. Ses recherches sont axées sur la simulation numérique des variations climatiques à l’aide de modèles de systèmes terrestres mondiaux et régionaux. La modélisation du climat donne un aperçu des processus susceptibles de provoquer des variations climatiques et des phénomènes extrêmes comme les tempêtes ou les sécheresses. La compréhension de ces processus sert de base pour améliorer la fiabilité des estimations quant aux changements futurs du système climatique. Contact :Prof. Christoph Raible, Département de physique du climat et de l’environnement (KUP), Institut de physique, et Centre Oeschger pour la recherche climatique, Université de Berne |
01.03.2024